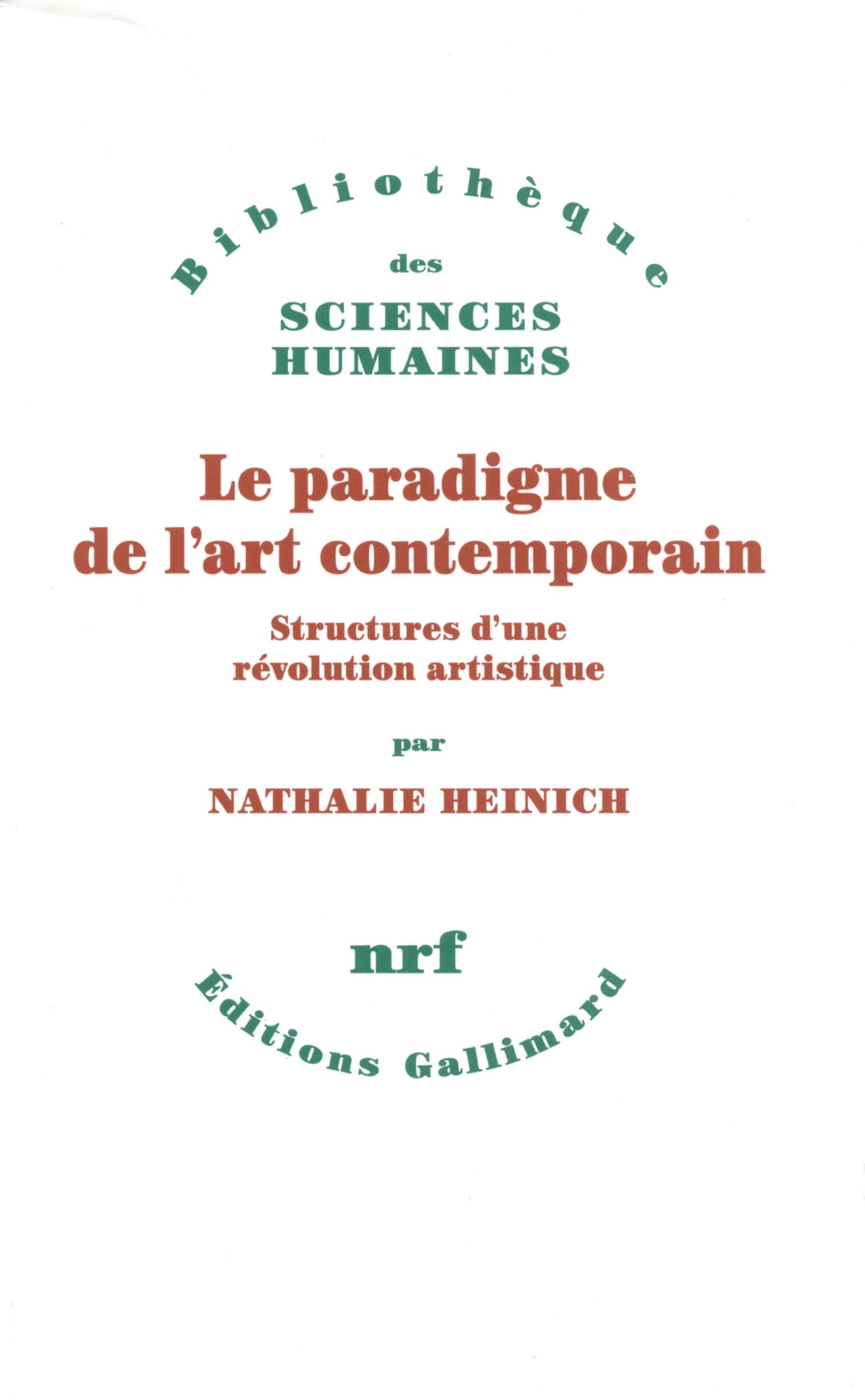La transgression de l'art contemporain. Interview avec Nathalie Heinich.
Nathalie Heinich est une sociologue française, directrice de recherche au CNRS, au sein du Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Outre de nombreux articles dans des revues scientifiques ou culturelles, elle a publié plus de trente ouvrages (traduits en une quinzaine de langues) portant sur le statut d’artiste et la notion d’auteur, l’art contemporain, la question de l’identité, le rapport aux valeurs, ainsi que l’histoire de la sociologie. Nathalie Heinich publie un nouveau livre le 20 février 2014, Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, aux éditions Gallimard.
Quel est le sujet de votre nouvel ouvrage, Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique?
Le sujet de ce livre prolonge mes premiers travaux, où j’étudiais le fonctionnement de l’art contemporain à partir de ses rejets, c’est-à-dire en montrant comment les œuvres d’art contemporain ont comme caractéristique de transgresser les frontières de ce qui, pour le sens commun, est considéré comme de l’art. Ces transgressions entraînent des réactions négatives, tandis que les propositions des artistes se trouvent intégrées dans le monde de l’art par les professionnels de l’art contemporain, les intermédiaires spécialisés. C’est ce triple jeu de transgression-réaction-intégration que j’ai étudié, et que j’approfondis aujourd’hui.
Dans ce livre, mon objectif est de systématiser une intuition que j’avais déjà eue à l’époque : l’idée que le monde de l’art contemporain n’est pas tant une catégorie chronologique qu’une catégorie générique : il a sa propre spécificité, qui le différencie non seulement de l’art classique, mais aussi, et surtout, de l’art moderne. C’est une chose que les gens ont bien souvent du mal à comprendre, car beaucoup confondent encore art moderne et art contemporain.
J’ai ainsi utilisé le terme « paradigme », que l’épistémologue Thomas Kuhn avait utilisé pour caractériser les révolutions scientifiques : selon lui, le progrès n’est pas le fruit d’une évolution linéaire, avec une découverte qui viendrait s’ajouter à une autre, mais d’un grand chamboulement des conceptions mêmes de la science et du type de questions qui méritent d’être posées, et pas seulement de leurs réponses.
J’ai transposé cette idée au monde de l’art, en montrant que dans le monde occidental, il y a trois grands paradigmes qui se sont succédé : le classique, le moderne et le contemporain. J’essaie de caractériser ce paradigme de l’art contemporain, et d’expliquer en quoi il se différencie radicalement du moderne. Dans le même temps, je montre tout ce qu’il y a en commun dans toutes les formes d’art contemporain, depuis les années 50 avec Rauschenberg, Gutaï et Klein. Je mets donc en avant ce qui fait l’unité, la grammaire commune de l’art contemporain, plutôt que ses différences de courants.
L’unité dans la diversité formelle ?
Pas seulement formelle. Je travaille cette question non pas du point de vue de l’historien de l’art, mais d’un point de vue sociologique, en montrant comment cette spécificité de l’art contemporain se manifeste non seulement dans l’apparence des œuvres, mais aussi dans leur définition et surtout dans le fonctionnement du monde de l’art — la façon d’exposer les œuvres, le rôle des intermédiaires, la place du marché, les façons d’exposer, de collectionner, de conserver, de restaurer, etc. - toutes sortes de problèmes qui se posent aux professionnels du monde de l’art.
Quelles sont donc les grandes caractéristiques de ce paradigme de l’art contemporain ?
Il repose sur l’impératif de transgression des frontières, ou d’expérience des limites. À partir de là, il en découle plusieurs conséquences, notamment le fait qu’en art contemporain, l’œuvre n’est plus dans l’objet proposé par l’artiste, mais dans l’ensemble des opérations que cette proposition produit : des discours, des récits, des problèmes, des actions, des expériences. L’art contemporain est plutôt un art de l’expérience à l’occasion de l’objet proposé, et non plus un art où l’œuvre consisterait en l’objet lui-même. D’où la difficulté qu’ont les non-initiés, qui fonctionnent avec les paradigmes classique et moderne, à identifier, tout simplement, ce qu’est une œuvre d’art contemporain. Par exemple, ils ne voient pas que dans une installation de Buren, l’œuvre n’est pas constituée par les rayures, mais par l’ensemble de l’espace reconfiguré par les rayures. C’est un exemple parmi d’autres.
C’est donc la première conséquence : une conséquence littérale de la transgression des frontières, puisque ce sont les frontières mêmes de l’œuvre qui sont transgressées dès lors que l’œuvre va au-delà des limites de l’objet proposé par l’artiste.
Une seconde conséquence est que les discours qui accompagnent l’œuvre sont tout aussi importants que l’objet lui-même. La présence de l’artiste a aussi une grande importance dans la présentation de l’œuvre : il doit être présent, même si cette présence est déléguée par des textes. Ces propositions creusent ainsi une distance de plus en plus grande avec le public, de sorte que les intermédiaires sont toujours plus nécessaires pour établir le lien. D’où l’importance des conservateurs, critiques, galeristes, commissaires, etc. – entre autres multiples conséquences.
En outre, les œuvres d’art ne se reproduisent pas, elles se racontent. L’art contemporain est en grande partie un art du récit, qui tend à se rapprocher du spectacle vivant plutôt que des arts plastiques. Il y a là aussi un brouillage des frontières.
Quelle est la place du prescripteur dans ce nouveau paradigme ? Vous montrez l’importance de l’intermédiaire, mais qu’en est-il de la place du critique ? On pense par exemple à Marc Spiegler qui a quitté son métier de critique pour devenir directeur d’Art Basel en 2007 après avoir écrit l’article polémique Do Art Critics still matter ?
C’est un élément qui n’est pas entièrement constitutif de l’art contemporain. Cela relève d’un phénomène apparu il y a une vingtaine d’années, et qui est très présent aujourd’hui, à savoir la formation de ce que j’appelle une « bulle artistico-financière ». Les raisons de cette bulle ne sont que partiellement liées à l’art, mais surtout à l’évolution économique du monde occidental, à la financiarisation, à l’émergence des traders et de grandes fortunes faites rapidement, aux pays émergents et à leurs nouvelles économies, donc à des masses d’argent disponibles, qu’il faut dépenser. Certaines tendances de l’art contemporain, qui ne nécessitent pas une très grande culture pour être appréciées, sont bien adaptées à ce phénomène spéculatif, surtout avec un genre qui s’est développé dans les années 90, un genre qu’on peut dire « sensationnaliste », pour reprendre le titre de l’exposition « Sensations » organisée par Charles Saatchi — avec des propositions souvent choquantes, immédiatement compréhensibles, jouant souvent sur le kitsch et la culture populaire. En somme, des œuvres qui n’exigent pas une grande connaissance de l’histoire de l’art pour être appréciées, et qui permettent aux porteurs de ces nouvelles fortunes d’investir dans ces œuvres, que ce soit pour des raisons esthétiques ou financières, ou les deux.
Avec cette bulle artistico-financière, le secteur privé des galeries, des foires, des marchands, a repris une importance qu’il avait perdue avec le passage de l’art moderne à l’art contemporain. Car dans les premiers temps de l’art contemporain, on a assisté à une montée en puissance du secteur public, des musées, des centres d’art et des critiques, et de courants plus conceptuels. Dans la seconde génération de l’art contemporain, à partir des années 90, on a vu cette prééminence du discours et de l’intellect perdre de sa force au profit d’une recrudescence du marché, avec notamment la prolifération des foires et l’augmentation spectaculaire des prix. On peut comprendre en effet, dans ces conditions, que quelqu’un qui veut peser sur le monde de l’art préfère devenir directeur de foire plutôt que critique. Mais là, on n’est pas dans le « tout » de l’art contemporain, mais seulement dans l’un de ses aspects très circonscrits dans l’espace et le temps.
L’art contemporain a-t-il vu évoluer la place de l’artiste — acteur majeur du paradigme ?
Ce qui est resté constant depuis la période romantique, c’est l’idée de la marginalité de l’artiste. On est dans un régime de singularité qui, non seulement ne s’est pas périmé mais qui, au contraire, s’emballe. Il y a une hypersingularisation en art contemporain, qui est la conséquence directe de sa définition transgressive. Dès lors qu’une œuvre transgresse des limites, on est forcément dans une singularité exacerbée.
Mais avec l’art contemporain, cette singularité peut se définir de toutes sortes de façons, et pas seulement, comme c’était le cas dans le paradigme moderne, avec la figure de l’artiste bohème, qui gagne peu mais sera sans doute promis à un grand avenir. La singularité aujourd’hui peut aussi se construire contre ces clichés de l’artiste romantique, bohème. L’artiste contemporain peut se singulariser en portant un complet trois-pièces et en gagnant beaucoup d’argent, car cela va à l’encontre du cliché romantique.
Il y a donc aujourd’hui toutes sortes de profils pour l’artiste contemporain.
Quelle compréhension de l’art contemporain la sociologie amène-t-elle ?
J’ai l’habitude de dire que l’art contemporain est une sociologie. Il y a une forme de porosité entre les deux, parce qu’un artiste contemporain travaille autant sur le contexte que sur la proposition elle-même — le contexte du monde de l’art, et le contexte plus général.
Mais pour revenir à la sociologie elle-même, il y a deux manières de répondre à cette question, c’est-à-dire de faire de la sociologie de l’art. La première, assez démodée, consiste à montrer que l’œuvre est une émanation de la société. C’est une approche assez dépassée, et qui, de surcroît, a perdu de sa spécificité sociologique dans la mesure où elle a été utilisée par les critiques d’art dès les années 60 pour parler du pop art ou du nouveau réalisme. Ce discours est donc passé dans le monde de la critique d’art ; et surtout, il n’a pas besoin d’enquête pour s’énoncer – or le propre de la sociologie, du moins à mes yeux, est de s’appuyer sur des études.
La sociologie est donc un travail d’enquête, qui permet d’étudier des choses qui sont souvent connues par les acteurs, mais qui ne sont pas vues pour ce qu’elles sont : par exemple, le rôle fondamental des intermédiaires de l’art. La mise en rapport des œuvres d’art avec leurs publics repose sur des procédures précises et complexes, faisant intervenir des acteurs institutionnels — les foires, biennales, expositions —, sur des personnes — critiques, galeristes, collectionneurs et commissaires d’exposition —, des objets, comme les murs des musées, et des matériaux, comme les livres ou les catalogues, ou encore sur les actions par lesquelles les objets sortent des ateliers des artistes pour parvenir dans des musées ou chez des particuliers. Tous ces éléments d’intermédiation entre les œuvres et le public sont fondamentaux, et ce sont des éléments passionnants, que la sociologie peut étudier, à condition de faire des enquêtes, d’observer le détail des situations artistiques. C’est cela, en tout cas, qui me passionne.
Article publié dans Art Media Agency, le 13 février 2014