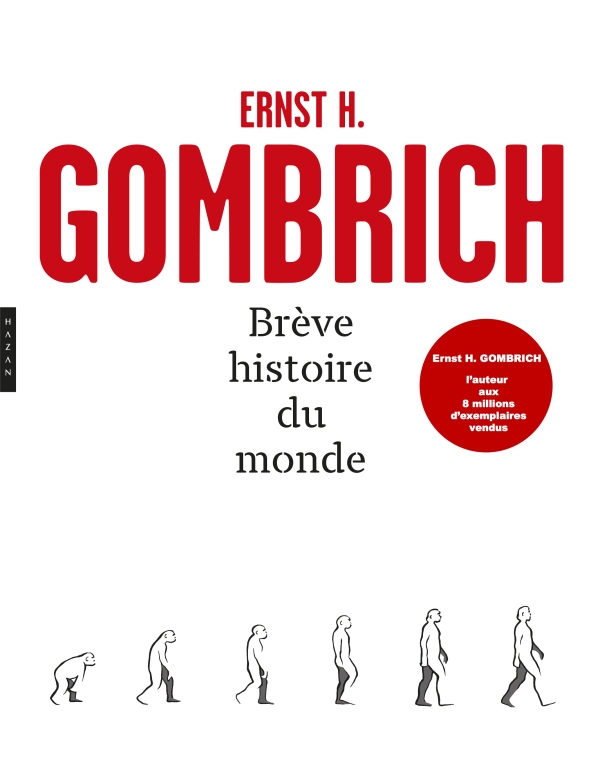Varia
Antonello da Messina, sous la direction de Caterina Cardona et Giovanni Carlo Federico Villa, Milan, Skira, 2019.
Comment aborder un peintre, Antonello da Messine (1430-1479), dont on mesure l’influence qu’il a eue à la Renaissance, notamment à Venise (1474-1476), mais dont les vicissitudes du temps n’ont laissé que des traces fragmentaires ? Quelques années après son passage vénitien, le maître sicilien n’avait pas fait école et déjà était oublié - tant, qu’on attribuait ses tableaux à d’autres, souvent van Eyck ou Memling -, et l’on a perdu près de 80 % de sa production dans diverses catastrophes, la plus importante étant le tremblement de terre qui a ravagé Messine en 1908 - point d’intérêt, on ne connaît que ses derniers travaux, œuvres de sagesse. Ce n’est donc pas une surprise de voir la belle monographie éditée par Skira (dans la qualité des textes et des reproductions, ce que l’on peut attendre de la maison), à l’occasion de la grande exposition qu’a eue le peintre à Milan entre février et juin 2019, s’enfoncer dans les incessantes querelles qui subsistent sur les attributions et les sources disponibles, les doutes historiographiques qui agitent encore les universitaires au sujet d’un peintre adulé, bien que mal connu. Vasari disait d’Antonello da Messine qu’il avait appris la technique de l’huile de Van Eyck lui-même, ce qui est faux, même s’il a effectivement synthétisé dans sa pratique les techniques à l’huile flamandes - notamment les glacis terminaux, les modelages de carnations - avec la détrempe à l’œuf, et a été un trait d’union entre les deux régions. Ses portraits au naturalisme sensible et aux regards magiques de vie, n’ont peut-être pas « amené le volume et la lumière dans la peinture » comme l’écrivait Roberto Longhi, mais les ont structurés, et ont ouvert, dit-on, la voie à l’école vénitienne - notamment à travers l’influence qu’il aura eu sur Giovanni Bellini. Le catalogue de Skira reproduit les pièces majeures du peintres, en les agrémentant de divers essais, et plus original, de la mise en exergue de certaines peintures du Sicilien qui sont l’occasion de saillies plus poétiques, en tout cas plus subjectives, que les essais, denses et formels. Ces derniers, sans s’attacher à produire une mythologie ou une narration qui soit cohérente, sont sincères et reconnaissent les lacunes des sources à partir desquelles nous reconstruisons la vie du peintre. Ils déploient en fait les différentes strates historiques permettant de l’aborder aujourd’hui : sa biographie avec l’essai « In search for Antonnello » de l’historien d’art Renzo Villa, très complet et sourcé, l’histoire de ses redécouvertes, notamment à travers un portrait poignant de Giovanni Battista Cavalcaselle (« From Myth to History, The Antonello of Cavalcaselle » de Giovanni C.F. Villa), historien d’art de terrain du XIXe siècle, qui par une méthode très pragmatique, un « positivisme philologique » entre reproductions sur carnet des œuvres croisées partout en Europe pendant des décennies (beaucoup de pages sont reproduites dans l’ouvrage) et annotations diverses et fragmentaires, est parvenu empiriquement à attribuer une bonne partie des pièces que l’on reconnaît aujourd’hui de la main du Sicilien. Deux derniers essais (« Antonello on Show » de Gioacchino Barbera et « With or Without Flanders » de Gianluca Poldi) permettent de revenir sur le passé des expositions et la technique picturale d’Antonello da Messine. Cette monographie, au-delà des longues heures de contemplation silencieuses qu’offrent les images somptueuses d’Antonello da Messine, ouvre donc une approche féconde, large et organique pour les aborder.
Brève histoire du monde, Ernst H. Gombrich, Paris, Hazan, 2018.
C’était déjà un best-seller qu’a réédité Hazan en novembre 2018. Cette Brève histoire du monde, rédigée originellement en 1935 et publiée en 1936, est un projet ambitieux du célèbre historien d’art Ernst H. Gombrich, une synthèse de l’Histoire de l’humanité, du paléolithique à l’ère industrielle, en quelque 300 pages. Un projet sans prétention à l’exhaustivité, c’est évident, mais avec celle de construire un grand roman, de mettre en lumière certains évènements, certains illustres et certaines théories, le tout considéré dans une continuité qui confère à l’Histoire des airs de fiction — cette approche presque romanesque se retrouve d’ailleurs dans son Histoire de l’art (1950) et affleure aussi dans la monographie qu’il écrira bien plus tard sur Aby Warburg (1970).
La petite histoire de « cet ouvrage [qui] ne prétend pas et n’a jamais prétendu se substituer à un livre d’histoire, dont les visées pédagogiques sont bien différentes », comme l’énonçait son auteur, éclaire son contenu. C’est à 26 ans au sortir de sa thèse en considérant, avec déception, le projet de traduction en anglais d’un ouvrage italien d’histoire universelle à destination des enfants, qu’Ernst H. Gombrich a décidé de réaliser le sien, pour pallier les lacunes de ce dernier. Dans cet ouvrage écrit en six semaines seulement, Ernst H. Gombrich s’adresse à son lecteur par le tutoiement. Cette Brève histoire du monde majoritairement politique et religieuse, est brossée à grands traits à travers l’anecdote. Même si le livre s’adresse à des lecteurs de jeune âge, c’est un travail de synthèse à mettre entre toutes les mains, puisque Gombrich a su insuffler plusieurs niveaux de lecture dans ce texte, notamment à travers d’étonnants jugements de valeur que le jeune historien porte sur sa discipline et l’Histoire elle-même.