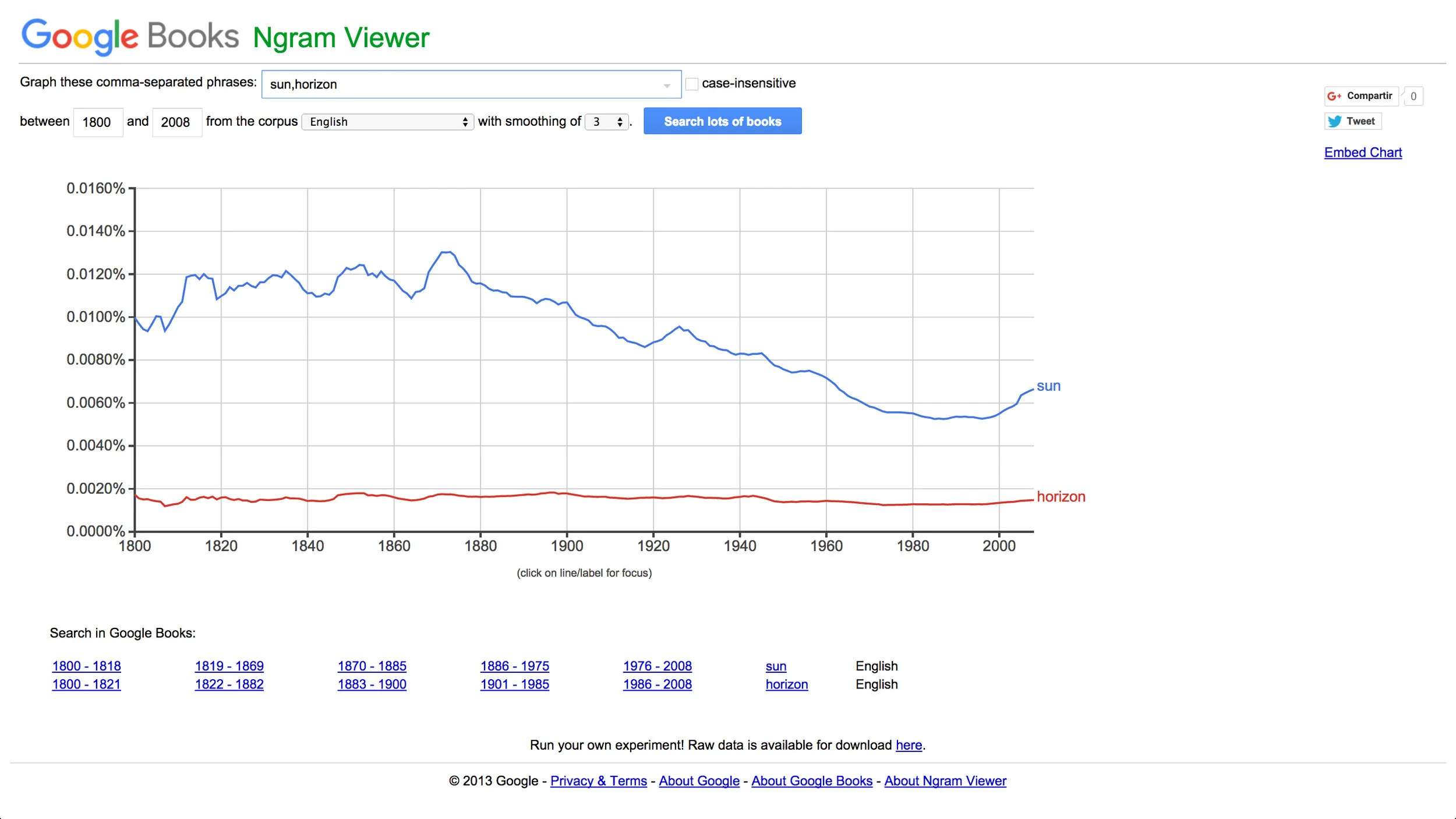Dominique Moulon, de l’évolution des arts numériques et de la porosité dans le monde de l’art
Critique d'art et commissaire d'exposition, Dominique Moulon est spécialiste des arts numériques et des nouveaux médias. Il est notamment l’auteur d’Art Contemporain Nouveaux Médias (Scala) ainsi que d’Art et Numérique en résonance (Scala). Il réalise actuellement une thèse — L’art au-delà du numérique. Cette année, il sera une nouvelle fois directeur artistique de « Variation Paris, Media Art Fair » qui se déroulera du 18 au 23 octobre 2016 à la Cité Internationale des Arts (Paris) pendant la Digital Art Week.
Quel est le sujet de recherche de votre thèse ?
Elle est intitulée L’art au-delà du numérique, Pratiques numériques plurielles d’un art contemporain singulier. L’idée étant de considérer, comme le fait Norbert Hilaire, le « coefficient de numéricité » d'œuvres contemporaines, en référence à Marcel Duchamp et son « coefficient d'art »
Nombre d’oeuvres numériques s’inscrivent dans la continuité de l’histoire de l'art : dans la continuité du cinétisme — dont le numérique permet de contrôler le mouvement —, de la vidéo, de la photographie, etc. Je souhaite aussi considérer le changement d’échelle que l’on a vu s’opérer progressivement, ne serait-ce que parce qu’aujourd’hui nous tenons le monde dans nos mains avec nos smartphones. Des oeuvres documentent cette mutation et ce qu’est devenue la société. Je problématise les grandes thématiques du numérique, devenues des thématiques de l’art contemporain ou plus largement de la société elle-même — la surveillance par exemple. Les grandes tendances du XXe siècle peuvent aujourd’hui être repensées à travers du prisme du médium numérique.
Il y a enfin les oeuvres qui apparaissent comme la conséquence d’Internet — ce que l’on appelle le « post-Internet » ou, plus largement le « post-digital ». Dans les années 1990, on a vécu une forme de virtualisation du monde. Aujourd’hui, on remarque chez les artistes une volonté de rematérialsier l'art, le monde. C’est pour cela que l’on parle de « nouvelle matérialité » — on aime les termes dans le monde de l’art.
Comment s’est opérée cette mutation ?
Dans les années 1980 puis 1990, le numérique était encore réservé à quelques happy few et considéré comme un outil — même si je pense qu’il est plus intéressant de le considérer comme un médium. Le monde de l’art ne s’y est pas intéressé spontanément, pour des questions de pérennité, de culture, d’habitude ou de marché. Plus récemment, l’arrivée d’Internet — ou plus précisément du Web participatif — a amené la société dans son ensemble à se saisir du numérique. La grande mutation qu’a apportée le Web 2.0, c’est que le numérique est passé d’outil à culture. Cette culture nous influence toutes et tous et c’est ainsi qu’ont émergé des oeuvres hybrides, dont on ne sait pas très bien si elles appartiennent à un art numérique ou contemporain.
En fait, le grand problème des pratiques numériques dans les années 1990 a été de s’exprimer essentiellement en black box, donc loin du white cube — dispositif de monstration privilégié de l'art contemporain — et en parallèle du marché. Aujourd’hui, on observe une fusion. Des artistes reconnus adoptent des pratiques hybrides et les natives digitaux usent de ces mêmes pratiques ou de cette culture pour documenter la société telle qu'elle est, façonnée par les technologies et intègrent les circuits de l'art.
Actuellement, on constate la victoire du white cube. Les pratiques numériques, qui appartenaient aux réseaux ou à la black box, migrent vers les espaces consacrées de l’art contemporain.
L’art numérique est en cours de légitimation. Dans les années 1990, les circuits de validation étaient parallèles, mais tendent à fusionner…
Les arts numériques se sont essentiellement développés en festivals — d’ailleurs c’est pour ça qu’ils sont très présents dans les régions du monde bénéficiant d’aides publiques comme le Canada ou l’Europe. Les pratiques de l’immatériel, qui ont un peu effrayé les institutions du fait de leur pérennité non-assurée, se sont rapprochées du monde de la recherche dans les années 1990.
Aujourd’hui, on voit ces festivals migrer vers d’autres directions. D’un côté se trouvent ceux qui s’intéressent vraiment à la recherche et se posent des questions sociétales — Transmediale (Berlin, Allemagne) ou Ars Electronica (Linz, Autriche) — et d’autres événements — la Biennale Némo (Ile de France) ou Elektra Biennale Internationale d'Art Numérique (Montréal, Canada) — qui migrent vers une forme d'art contemporain numérique. La seconde édition d’Elektra s’est faite dans le musée d’art contemporain de Montréal, ce qui est tout à fait révélateur. Bref, certains festivals se focalisent sur des approches scientifiques, d’autres intègrent les circuits de validation de l’art contemporain.
Le ZKM (Karlsruhe, Allemagne) illustre bien cela : il possède à la fois un musée des technologies et un centre d’art contemporain, tout en étant tenu par un artiste, Peter Weibel, qui vient du monde de la performance — une forme déjà hybride de l’art. Ce que j’aime dans l’approche de Peter Weibel, c’est la porosité qu’il a su insuffler entre un centre des médias et un centre d'art tout en s’intéressant aux artistes contemporains légitimés par ses instances.
Les circuits de validation qui ont été relativement parallèles, dans les années 1990 et au début des années 2000, se croisent aujourd’hui — dans les festivals, le marché, la théorie et la critique, etc. Cory Arcangel est représenté par Thaddaeus Ropac, Raphael Lozanno-Hemmer vient d'être exposé à Unlimited à Art Basel en 2016, etc. Le marché est un moteur de cette hybridation.
Et les artistes ?
J’aime dire que les artistes utilisent les technologies de leur temps. Certains ont utilisé la camera obscura, d’autres la photographie, puis la télévision, la vidéo, etc. Aujourd’hui, nous vivons l’ère des usages détournés des innovations d’entreprises pour faire oeuvre. Les classifications et nomenclatures importent peu. Ce qui a fait l’émergence de l’art vidéo, c’est la portabilité de la caméra Sony Portapak, ce qui fait la ré-émergence de l’auto-filmage, c’est l'usage de la webcam associée à celui de YouTube — d’où l’idée de « ré-émergence » défendue dans mon exposition de Montreuil.
Cette triple exposition à la Maison Populaire de Montreuil était intitulée « L’art et le numérique en résonance », autour des concepts de convergence, de ré-émergence et des conséquences. Pouvez-vous revenir sur ces idées ?
L’idée de l’exposition était d’interroger la part du numérique dans l’art contemporain, en considérant les oeuvres qui se placent dans la continuité du XXe siècle — vidéo, photographie, etc. —, mais à l’ère du numérique et en considérant également les pratiques conséquentes au numérique donc « post-digital ».
Les artistes sont cultivés, ils connaissent l’histoire de l’art. En outre, aujourd’hui, il n’émerge pas une innovation technique ou technologique sans qu’un artiste ne s’en empare pour la détourner ou pour l’interroger.
En bref, je souhaitais faire cohabiter des artistes que l’on ne retrouve rarement ensemble : Cory Arcangel, Renaud-Auguste Dormeuil, Thibaut Brunet, etc. Toutes leurs oeuvres avaient un « coefficient de numéricité » — ne serait-ce que quand un artiste se documente sur Internet. Toute la création est imprégnée de numérique ! Toutes les oeuvres exposées avaient quelque chose de numérique, plus ou moins visible. Et ce n’est pas dans le fait que les oeuvres soient visiblement numériques que se portait mon intérêt, mais dans le fait que le numérique façonne l’art et le monde.
Certains théoriciens comme Lev Manovich pensent la fin — ou le déclin — de l’idée de médium, incapable de créer une typologie cohérente de la production artistique au XXIe siècle. Qu’en pensez-vous ?
On peut déjà penser l’obsolescence du médium numérique bien qu’il n’ait pas encore véritablement intégré les circuits de l’art dans la mesure où l’on vit aujourd’hui dans une forme d’hybridation — et c’est cette hybridation des médiums qui met justement en crise le concept. Je pense que l’on vit une période où le médium a effectivement tendance à s’effriter, dans le sens où les oeuvres ne sont ni totalement photographiques, ni totalement picturales, ni totalement numériques, etc. Après, je continue à croire en l’idée de médium.
Aujourd’hui, il semble nécessaire de penser la conservation et l’obsolescence des oeuvres numériques, tout comme il semble nécessaire de penser une histoire de l’art numérique, qui a déjà 50 ans. Comment penser la « durée » de l’art numérique ?
Cela reste une véritable problématique. Il y a quelques institutions qui s’intéressent vraiment à ces questions comme le ZKM ou le V2 Institute for the Unstable Media (Rotterdam).
Encore une fois, les choses se sont complexifiées et sont devenues poreuses. La pérennité est certainement moins importante aujourd’hui dans le monde de l’art dans le sens où l’on a vu un certain nombre de pratiques de l’art contemporain ne prenant pas en considération la conservation. On le vérifie par exemple avec les pièces de Damien Hirst, dont on sait que certaines sont en décomposition. Beaucoup d’oeuvres vont disparaitre. Même problématique avec les téléviseurs cathodiques de Nam June Paik par exemple. Les oeuvres de Land Art aussi vont disparaitre quand elles n'ont pas encore disparu, mais si elles sont documentées alors nous pourrons tout de même en garder des traces.
Si l’artiste, de son vivant, documente son travail, notamment par des instructions ou protocoles, il sera alors plus facile de réactiver ses oeuvres dans le respect de son travail. Je pense que les technologies nous encouragent à documenter les oeuvres afin de ne pas les perdre — idéalement pour pouvoir les réactiver, au moins pour en garder des traces. Ces problématiques d’oeuvres de protocole ont déjà été largement ouvertes par d’autres formes artistiques comme l’art conceptuel ou la performance.
En même temps, je pense qu’il faut savoir accepter que des oeuvres disparaissent, comme celles du Net art des origines, qui ne sont lisibles qu’avec les premières versions de Netscape. Certains artistes du Net art ont même choisi de laisser leurs oeuvres en désuétude — Shulgin par exemple.
Je pense que cette question de la pérennité a initié quantité de conférences dans les années 1990, puis 2000 pour finalement produire plus de réflexion sur le contexte des oeuvres que sur les oeuvres elles-mêmes. Il a aussi émergé une nouvelle génération de collectionneurs, qui sait acheter des oeuvres à « obsolescence programmée ».
Quelle est votre vision de Variation ?
Je souhaite défendre les artistes à travers une scénographie ouverte, qu’ils soient ou non représentés par des galeries, aidés ou non par des producteurs. Il est important de travailler avec le marché et de présenter des oeuvres pour qu’elles échangent entre elles sans se poser la question de savoir si la galerie a les moyens de payer son espace ou de produire. C’est la spécificité de Variation, c’est une foire qui ne coûte rien à personne — ni au visiteur, ni à l’artiste, ni à la galerie qui ne loue pas d’espaces ou ne produit pas les oeuvres. Le modèle économique fonctionne parce que la foire prélève un pourcentage sur ce qui se vend — un modèle hybride entre la foire et le salon.
Pour leurs acquisitions, les grandes institutions se tournent vers les galeries, les foires, les biennales — contrôlées par le marché. Je suis pour la porosité, entre le monde de l’art et le marché, les festivals et les institutions, voire les entreprises, les mécènes et les artistes. Tout cela pour servir l’art et le préserver.
Article publié dans le numéro spécial FIAC d'Art Media Agency, octobre 2016