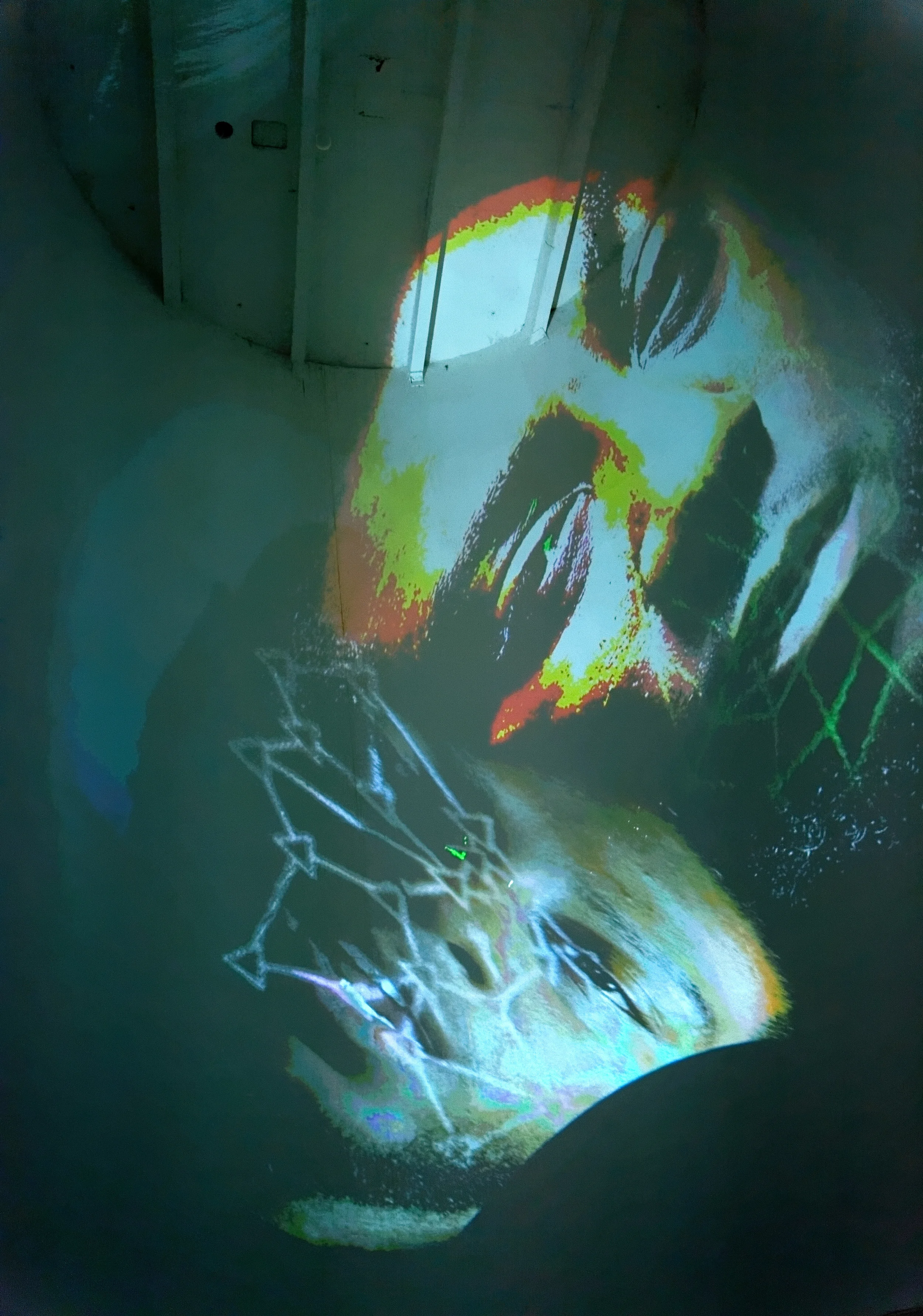La vie moderne, selon Thierry Raspail
Thierry Raspail, directeur de la Biennale de Lyon [à Lyon, en France, jusqu'au 3 janvier 2016] depuis son lancement en 1991, est également directeur du MAC Lyon depuis sa création en 1984. Après avoir assuré lui-même la direction artistique des trois premières éditions, Thierry Raspail a confié la direction artistique de la biennale à différents commissaires avec lesquels il définit un thème décliné à chaque fois sur un ensemble de trois éditions — selon le principe du triptyque. En 2015, la Biennale ouvre une trilogie sur le moderne, inaugurée par « La vie moderne », sous le commissariat de Ralph Rugoff — directeur de la Hayward Gallery, à Londres.
Cela fait quelques semaines que la 13e Biennale de Lyon a commencé.
Pour l'instant, nous avons la chance de faire l'objet de critiques très positives de la part de la presse, à une exception près. Les résultats en termes d'audience sont excellents et même inattendus. Les artistes nous ont aussi envoyé des messages témoignant de leur grande satisfaction. Je ne veux pas insister, mais nous devons admettre que cette édition a très bien commencé.
Le monde compte aujourd'hui entre 150 et 200 biennales. Comment vous distinguez-vous parmi cette offre presque pléthorique ?
À l'échelle de la planète, je ne parlerais pas d'offre pléthorique, c'est-à-dire de densité au km2. Après tout, la Biennale de Lyon est la seule de France. À ce titre, elle prend d'ailleurs la suite de la Biennale de Paris, créée par Malraux en 1959 pour tenter de lutter contre l'emprise grandissante de New York sur le bloc de l'Ouest. La Biennale de Paris s'est arrêtée en 1985 et nous avons pris le relais, un peu par hasard, en 1991.
À cette époque, en tant que spécialiste d'art contemporain lyonnais, j'avais été invité à réfléchir à un projet de musée. Nous baignions dans le post-modernisme, l'idée de fin de l'histoire et le globalisme. Nous réalisions que tout un pan de l’histoire de l'art que nous avions — peut-être sciemment — ignorée était en train de prendre le pouvoir. Il nous semblait que seule une programmation internationale, qui excéderait un projet de musée, pouvait contenir cette incroyable évolution.
D'ailleurs, c'est à cette époque que se sont lancées les Biennales de Shanghai, de Gwangju (Corée du Sud) ou encore de Johannesburg — qui n'a pas tenu malheureusement. C'était un projet culturel inédit à l'échelle globale, tout à fait nouveau pour les concepteurs de biennales européens. Nous voyions de nouvelles aires culturelles représentées sur la carte du monde de l'art — au sens occidental. La question des artistes contemporains non-occidentaux, nourris par la modernité occidentale et intégrés à un marché local était notamment devenu sensible à travers des expositions comme « Magiciens de la terre », de Jean-Hubert Martin, au Centre Pompidou en 1989.
Du coup, comme fait-on pour se distinguer ? Cela me semble assez clair : épouser ce mouvement de l'histoire de l'art et être mu par volonté de préserver ce dialogue simple et clair. C'est également par le choix des thèmes (le terme « Moderne » pensé par Ralph Rugoff pour cette nouvelle édition), toujours très vastes — ce que l'on me reproche parfois — et profondément intégrés à l'actualité.
Pourquoi avez-vous choisi d'exhumer le terme de « Moderne » ?
Pour l'Occident — et notre tradition de l'art —, c'est un mot définitivement enterré. Le « Moderne », c'est une période remplacée par le post-moderne depuis les années 1980 ; un courant formaliste pour les historiens de l'art américain ; l'invention de la perspective pour les Européens ; ou même, pour les historiens, une période qui démarre au néolithique. Pourtant, ce mot n'est pas enterré de la même manière par toutes les aires culturelles — celles-là mêmes qui se sont invitées au banquet de l'art contemporain alors quel'Occident se refusait de les inviter.
Depuis la fin des années 1980, l'art contemporain intègre de nouvelles aires culturelles à son giron, qui redonnent ses lettres de noblesse au terme « Moderne ». Non seulement, ces nouvelles aires culturelles acceptent l'idée de l'artiste individuel-créateur, ancré aussi bien à l'histoire qu'au présent, mais elles reconnaissent aussi les nouvelles formes introduites par la Modernité Occidentale : le ready-made, le Cubisme, Matisse, l'art vidéo, l'art corporel ou la performance, etc. Les artistes non-occidentaux reprennent les formes inventées dans un véritable entre-soi par l'Occident et les font revivre. Pour nous, le Moderne est obsolète ; pour ces artistes, il est bien vivant. Ils l'enrichissent de nouveaux enjeux et de nouveaux récits, locaux, traditionnels et contemporains.
À l'inverse, les Européens ne croient plus vraiment à la Modernité, ni à l'Histoire en général. Pour le reste du monde, la question de la globalisation achevée marque une modernité dont il faut écrire le présent, c'est-à-dire le futur.
Sur la Biennale de Lyon, il ne s'agit donc pas tant de redéfinir le moderne que de montrer à quel point cette notion est aujourd'hui partagée. Elle cristallise des enjeux esthétiques et sociétaux, comme l'environnement ou la démocratie.
En Occident, le Moderne a disparu avec la dislocation des grands récits mais semble reparaître à mesure que notre ethnocentrisme est remis en question par ces histoires multiples qui nous nourrissent.
L'ethnologie et l'anthropologie, en voulant connaître et rapprocher l'Autre, ont finalement creusé l'écart et fait apparaître un Autre définitivement autre. L'anthropocentrisme est inévitable — à la base de toutes ces histoires, il y a bien un fond commun qu'on appelle l'homme —, mais il doit être partagé. On ne peut plus penser l'anthropocentrisme — aussi bien que l'universalisme — tout seuls.
Cette notion d'histoire partagée est essentielle. Elle est manifeste dans les arts visuels, notamment via les nouvelles technologies de communication qui permettent par exemple à des artistes de collaborer en temps réel de part et d'autre de la planète. En plus de cela, des thèmes globaux comme le réchauffement climatique rapprochent les artistes.
Ces enjeux se retrouvent dans la 13e édition de la Biennale, que l'on a pu qualifier de pessimiste. Comment vous placez-vous par rapport à cela ?
D'abord, cette édition est la première d'un triptyque.
Ensuite, il est clair que Ralph Rugoff a voulu utiliser le terme « Moderne » dans son acception la plus large. Il s'est intéressé aux nouvelles formes produites par les artistes dans le monde actuel, à la génération post-médias — notamment marquée par cette fabrication frénétique d'images qui se superposent — et bien entendu aux enjeux sociétaux majeurs.
De ces œuvres engagées, il résulte une vision non pas pessimiste, mais du monde contemporain tel qu'il est. D'ailleurs, cette vision n'exclut pas l'humour. L'installation de Julien Prévieux, par exemple, est une sorte de musée de la triche dans lequel il rassemble ceux qui, dans le sport, ont essayé de tricher — une œuvre à la fois drôle et révélatrice de cet univers de compétition.
Cette édition témoigne également d'un fort ancrage local — avec les canuts dans une œuvre de Marina Pinsky ou les pneus de l'autoroute A7 dans l'installation de Nelson Mike.
Oui. Ralph Rugoff voulait commencer par la France, suivant cette idée qu'une biennale ne peut être internationale que si elle a un ancrage ! Il faut les deux bouts de la chaîne. Traditionnellement, les commissaires s'intéressent au local en dernier : Ralph Rugoff a fait le chemin inverse.
Cela me semble symptomatique de l'intérêt récent que nous avons pour la dialectique entre le global et le local. Vis-à-vis de cet ancrage, nous proposons également d'autres expositions dont j'ai été commissaire ou co-commissaire : l’exposition « Ce fabuleux monde moderne » programmée avec Ralph Rugoff au MAC de Lyon ; « Rendez-vous 15 », consacrée à de très jeunes artistes du monde entier ; ou encore « Anish Kapoor chez Le Corbusier » pour laquelle l'artiste s'approprie le couvent de La Tourette, couvent dominicain en activité.
Avez-vous commencé à réfléchir au prochain commissaire, pour l'édition 2017 ?
On est toujours en train de réfléchir au prochain commissaire, mais c'est un peu tôt pour en parler !
Le rythme des biennales a changé. S'il était assez lent auparavant, il s'est profondément accéléré depuis quelque temps — d'ailleurs les organisateurs s'intéressent de plus en plus au format de la triennale.
Des biennales dans le monde entier proposent de nouvelles choses en permanence et il faut savoir rester au niveau.
Comment avez-vous vu évoluer le statut des biennales depuis deux décennies ?
Elles sont devenues de véritables outils stratégiques. Par exemple, quand l'Afrique du Sud sort de l’apartheid, en 1991, et qu'elle décide de le faire savoir au monde entier, elle choisit notamment d'organiser une biennale. Le problème cependant, c'est qu'on ne peut pas concevoir une biennale à Johannesburg après des années d'apartheid comme si elle se tenait à New York ou à Londres.
Pour des raisons différentes, mais également géostratégiques et culturelles, Singapour a également créé sa biennale. Singapour, qui a une économie florissante, est proche de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud où il existe plusieurs biennales. Face à cette concurrence, la Cité-État a décidé de prendre le leadership sur l'Asie du Sud-est.
Les enjeux culturels des pays prospères se manifestent notamment par l'art contemporain, notamment du fait de sa liberté — on peut faire aussi bien de la performance que de la peinture à l'huile. Tous les pays émergents ne disposent pas d'autant d'infrastructures muséales et, dans la mesure où ils veulent d'abord faire exister la culture avant d'étendre le marché, ils créent des biennales et non des foires.
Quels sont vos projets pour le MAC de Lyon ?
Nous allons exposer Yoko Ono [du 9 mars au 10 juillet 2016], qui a largement anticipé ces problématiques contemporaines et dont on n'a pas encore pleinement reconnu l'importance.
Interview parue dans Art Media Agency, le 6 novembre 2015